Bilan des Stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC)
Après 10 ans d’existence de la Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière (SRGBC) et la mise en œuvre de programmes d’actions opérationnels sur la gestion de l’érosion, le GIP Littoral et les partenaires ont souhaité lancer une démarche d’évaluation approfondie des initiatives mises en place pour anticiper et gérer les risques d’érosion sur le littoral. Cette évaluation sous forme de bilan s’inscrit dans un contexte réglementaire mouvant induit par l’adoption de lois récentes et la révision de cadres stratégiques (GEMAPI, Loi climat et résilience, Loi MADRAS, SNGITC en cours de révision...). Aussi, des nouveaux outils sont déployés pour répondre à la question croissante de gestion des risques et nécessitent une adaptation des territoires liée en particulier à des évolutions de gouvernance.
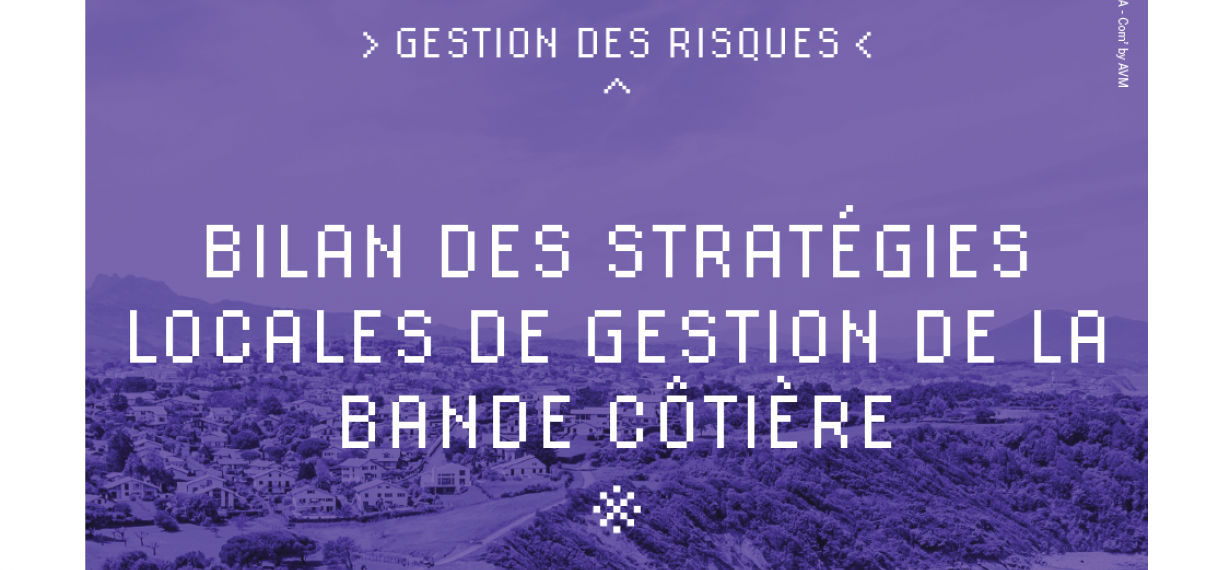
Contexte
En 2012, en articulation avec la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC), la Nouvelle-Aquitaine a élaboré une SRGBC, adaptée aux spécificités locales. La stratégie vise à renforcer la connaissance partagée de l’aléa érosion avec la production de la sensibilité régionale et à orienter les politiques publiques en fixant des principes et objectifs communs pour la gestion du littoral. Le cadre régional a servi de base pour l’élaboration des SLGBC, qui sont déclinées localement et volontairement par les collectivités territoriales afin de répondre aux particularités de chaque secteur côtier sur les côtes à falaises ou meubles. Ayant été établi que l’inaction coûterait plus cher que l’action, il a été décidé collégialement dans la SRGBC de ne pas retenir ce scénario dans les choix de gestion.
État d’avancement des SLGBC et réalisation d’un bilan sur 8 territoires
En Nouvelle-Aquitaine, une région particulièrement exposée aux phénomènes d'érosion en raison de sa diversité côtière (plages sableuses, falaises, estuaires), 13 SLGBC sont en cours d’étude ou d’application, avec 8 territoires ayant déjà finalisés leurs premiers programmes avec la réalisation d’un bilan pour entreprendre la mise en œuvre d’un deuxième programme d’actions (du Nord au Sud) : SLGBC de la Pointe Médoc Nord, de Lacanau, de La Teste-de-Buch, de Lège-Cap-Ferret, de Biscarrosse, de Mimizan, de Soorts-Hossegor, Capbreton et Labenne, et de la Côte Basque.
Ce bilan constitue une synthèse des enseignements tirés de la première génération des SLGBC. Il analyse les avancées réalisées, les défis rencontrés et propose des recommandations pour construire une gestion durable et résiliente des zones littorales. Il s’adresse aux décideurs publics, aux collectivités territoriales, aux gestionnaires du littoral, mais aussi aux citoyens concernés par la préservation de nos côtes.

Méthodologie
L’évaluation des SLGBC de 1ère génération en Nouvelle-Aquitaine a été conduite par le GIP Littoral à travers une méthodologie qui visait à dresser un bilan global des 8 SLGBC pour identifier les réussites, les défis et formuler des recommandations pour les futures stratégies. Aussi, elle a reposé sur l’analyse des bilans des territoires impliqués, incluant des rapports techniques, administratifs et financiers, ainsi que des avis techniques (GIP et Observatoire de la Côte Nouvelle-Aquitaine) émis par le Comité Régional de Suivi des Stratégies (CRSS). L’évaluation a porté sur trois volets principaux :
• Administratif : analyse de la gouvernance des SLGBC, du fonctionnement et de la régularité des comités techniques et de pilotage, ainsi que de la coordination entre les différentes parties prenantes. Ce volet a permis d’identifier les dynamiques partenariales, les modes de concertation et les éventuels obstacles administratifs.
• Financier : étude de la consommation budgétaire des SLGBC, avec une attention particulière portée à l’efficacité de l’utilisation des fonds, aux écarts entre les prévisions et les dépenses réelles, et aux difficultés liées à l’accès aux financements (FEDER...). Ce volet a notamment mis en lumière la nécessité d’ajuster les estimations budgétaires dans les seconds programmes.
• Technique : évaluation de la mise en œuvre des actions prévues dans les SLGBC selon les 8 axes d’intervention (connaissance de l’aléa, surveillance, gestion de crise…). Cette analyse a permis de mesurer le degré de réalisation des actions, d’identifier les conditions de réussites, et de mettre en évidence les freins rencontrés.
Parmi les enseignements fondamentaux, le rapport a mis en exergue la nécessité de s’appuyer sur des modes de gestion combinés oscillant entre l’accompagnement des processus naturels et les actions de lutte active (dure ou souple) et intégrant des opérations de repli stratégique. Ainsi, cette gestion de l’érosion doit s’adapter aux spécificités locales et être envisagée à différents horizons temporels avec une approche multiscalaire. La maitrise de l’urbanisation dans la bande d’aléa s’avère indispensable pour ne pas ajouter d’enjeu dans une zone vulnérable. La traduction effective est notamment retranscrite dans les documents de planification (Scot, PLU(i)) et les Plan de Prévention des Risques.
Des recommandations ont été formulées à l’issue de chaque partie afin de proposer des pistes d’amélioration pour les futures générations de SLGBC. L’analyse globale met en lumière les bonnes pratiques, les freins et les défis rencontrés, ainsi que les perspectives d’évolution nécessaires pour une gestion et une adaptation plus efficace et durable du risque érosion à l’avenir.
Enjeux à venir
La méthodologie régionale se décline en programme d’actions locaux intégrant des réflexions à court terme et des orientations à moyen terme (liées à des actions pérennes, transitoires, ou structurelles) pour tendre vers un territoire résilient à long terme. L’enjeu consiste à trouver le bon équilibre entre des actions de défense immédiates, des solutions basées sur la nature, de petites opérations de déplacement sans regret, et des opérations d’aménagement plus ambitieuses à long terme. Il s’agit de développer des politiques itératives et adaptatives, en tenant compte des incertitudes et en intégrant des "points de bifurcation" pour ajuster les stratégies en fonction de l’évolution des risques et des besoins, ainsi que du contexte sociétal qui évoluera sur ce temps long. L’évaluation des SLGBC s’est notamment attaché à montrer la nécessaire articulation et imbrication des stratégies de gestion de l’érosion avec les projets d’aménagements.
Dans un contexte de changement climatique, l’accélération de l’érosion, pouvant entrainer la perte de milieux dunaires jouant un rôle de protection naturelle, exposera les zones basses à des risques d’inondations de plus en plus fréquents.
Les enseignements tirés de ce bilan vont servir de socle pour une gestion plus ambitieuse et adaptée qui sera traduite dans la révision du guide de l’action locale en intégrant les évolutions réglementaires et en approfondissant certains sujets d’actualités (changement climatique, planification, combinaison risques érosion/submersion...).
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le rapport technique portant sur le bilan des SLGBC figurant sur l’onglet "pour aller plus loin".
Toutes les ressources "Gestion des risques"
ou toutes les ressources